Histoire de la Picardie
 Située au nord de la France, entre Paris et la Manche, la Picardie fut pendant des siècles une terre stratégique, convoitée et profondément marquée par les grands événements de l’histoire Française. La situation géographique de la Picardie la place au cœur des conflits européens : guerre de Cent Ans, chevauchées, puis aux XVIe et XVIIe siècles, troubles et occupations ponctuent son histoire. L’économie rurale évolue progressivement, mais reste marquée par la seigneurie et les structures agraires anciennes.
Située au nord de la France, entre Paris et la Manche, la Picardie fut pendant des siècles une terre stratégique, convoitée et profondément marquée par les grands événements de l’histoire Française. La situation géographique de la Picardie la place au cœur des conflits européens : guerre de Cent Ans, chevauchées, puis aux XVIe et XVIIe siècles, troubles et occupations ponctuent son histoire. L’économie rurale évolue progressivement, mais reste marquée par la seigneurie et les structures agraires anciennes.
L’histoire de la Picardie est celle d’une terre au cœur des enjeux européens, modelée par les combats, la foi, l’industrie et la résilience des femmes et des hommes qui l’ont habitée. Son patrimoine exceptionnel reste l’un des plus éloquents témoignages du passé de la France. Son patrimoine unique s’explique par une succession de périodes qui ont façonné son identité culturelle, politique et architecturale. Cathédrales classées à l’UNESCO, sites mémoriels, architectures traditionnelles et musées permettent aujourd’hui aux visiteurs d’explorer une histoire passionnante, entre grandeur médiévale et mémoire des conflits.
La Picardie raconte une histoire millénaire où se mêlent paysages de plaines calcaires, villes-cathédrales et mémoires de guerres. Cet article propose un parcours chronologique et thématique pour comprendre comment cette région a forgé son identité culturelle, sociale et politique, de la préhistoire aux recompositions contemporaines.
L’Histoire de la Picardie : un territoire façonné par les siècles !
De la Préhistoire à l'Antiquité
- 200 000 ans av. J.-C. : premières traces d'activité humaine en Picardie. La Picardie a été occupée dès le Paléolithique, avec des traces d’implantations humaines liées aux ressources des vallées de la Somme et de l’Authie. À l’âge du bronze et à l’âge du fer, la région voit l’émergence de habitats structurés et de réseaux d’échanges.
On estime que l'être humain est présent dans le Nord depuis plus de 600 000 ans. Lorsque les conditions étaient plus rudes, les hommes étaient contraints de quitter la région pour trouver refuge plus au sud. Parfois, certains étaient amenés à franchir le détroit du Pas-de-Calais à pied, le niveau de la mer pouvant être d'une centaine de mètres plus bas qu'aujourd'hui ! Les fouilles de Biache-Saint-Vaast ont permis de mieux connaître le mode de vie des hommes du paléolithique moyen. Ils sont alors chasseurs et non plus charognards. La phase récente de cette période, du début du dernier glaciaire à 35 000 ans, correspondant à celle des hommes de Néandertal.
La Picardie demeure une région ayant conservé de nombreux témoignages de l'ère préhistorique : à Abbeville avec des trouvailles datant du paléolithique, mais aussi dans l'Oise (à Breteuil, Jonquières ou Néry) et dans l'Aisne. La Somme peut être considérée comme le berceau de l'archéologie puisque c'est à Abbeville, au milieu du XIXe siècle, que Jacques Boucher de Perthes découvrit des silex taillés et des fossiles d'animaux dans des carrières aux abords de la ville.
C'est, pour lui, la preuve de l'existence de l'homme d'avant le Déluge : l'homme préhistorique était né. Un peu plus tard, sur un chantier d'extraction à Saint-Acheul, un faubourg d'Amiens, sont mis au jour des silex taillés qui seront baptisés acheuléens. Les outils de Saint-Acheul ont été datés d'environ 450 000 ans. Les plus vieux outils de ce type ont été trouvés en Afrique et datent de plus d'un million d'années.
Des origines gallo-romaines à l’émergence du territoire picard
- De 600 av. J.-C. à 58 av. J.-C. : civilisation gauloise et création d'oppidums jusqu'à la guerre des Gaules.
Le territoire de la future Picardie appartenait à la Gaule belgique. Les tribus gauloises qui peuplent les contrées picardes sont vaincues définitivement par Jules César en 51 avant J.-C. ou résistent pour finalement être incorporées dans la Gaule belge. Les peuples ambiens, bellovaques ou encore viromanduens fondèrent des centres importants comme Amiens (Samarobriva), qui devint une cité prospère sous l’Empire romain.
 Conquête et intégration de la Picardie dans l’Empire romain
Conquête et intégration de la Picardie dans l’Empire romain
La région qui deviendra la Picardie a été conquise lors de la campagne de César et intégrée à la Gaule romaine au Ier siècle avant notre ère, puis romanisée progressivement sous le Haut-Empire.
Les chefs des peuples belges installés dans la plaine picarde, notamment les Ambiani autour de la Somme, jouent un rôle central pendant la conquête et la transition vers la romanisation. Leur pouvoir local, leurs alliances et leurs capitulations ou résistances face à Rome déterminent les premiers rapports de la région avec l’Empire. Les institutions romaines ont organisé le territoire en cités et en réseaux administratifs qui ont structuré la vie politique et économique locale. L’arrivée des Romains inscrit la Picardie dans la Gaule romaine avec voies, villas et villes secondaires qui favorisent la romanisation progressive des populations locales.
Procurateurs, gouverneurs de cité et officiers militaires, parfois attestés par des inscriptions locales, organisent l’encadrement administratif, fiscal et militaire du territoire, supervisent les travaux publics et l’intégration des voies et infrastructures reliant Samarobriva (Amiens) au reste de la Gaule.
Prêtres civiques, responsables de sanctuaires locaux et du culte impérial assurent la romanisation religieuse et la médiation entre traditions gauloises et pratiques romaines ; des sanctuaires et temples découverts témoignent de leur présence et de leur importance sociale. Notamment dans la forêt d’Halatte, où se déroulaient offrandes, consultations et festivals locaux liant traditions gauloises et cultes impériaux. Développements singuliers à Champlieu, où se succèdent phases cultuelles et funéraires, traduisant des pratiques religieuses évolutives et des recompositions du paysage sacré à l’époque romaine.
Centres urbains et toponymie romaine
Amiens est la Samarobriva romaine et s’impose comme le principal centre urbain et administratif du territoire, siège de voies et d’un port sur la Somme qui assurent la circulation des personnes et des marchandises. Senlis et d’autres agglomérations conservent des traces d’aménagements publics comme des arènes, temples et thermes attestant d’un urbanisme romain développé.
Réseau de voies et infrastructures
La Picardie gallo-romaine est traversée par un maillage de voies reliant la région à Paris, à la Belgique romaine et aux côtes de la Manche, favorisant le commerce et la mobilité militaire. Des équipements ruraux et urbains comme des ponts, chaussées, installations portuaires, témoignent de la mise en place d’infrastructures destinées à intégrer la région au marché impérial. L'établissement de réseaux routiers également reliant Samarobriva à la Gaule Belgique et à Lutèce, est l'événement décisif pour l’essor urbain et commercial de la région.
Centurions et commandants de petites garnisons qui lèvent des troupes, sécurisent les axes routiers et protègent les établissements riverains contribuent à la pacification et à l’ordre public, facilitant le commerce et l’implantation romaine dans les vallées et sur les routes principales.
Construction d’infrastructures publiques et manifestations civiques
Édification d’équipements publics à Amiens et dans les agglomérations secondaires : thermes, ateliers, quais fluviaux et voiries, signes d’un niveau d’urbanisme romain durable. Construction d’un amphithéâtre à Senlis et d’aménagements spectaculaires associés aux loisirs publics, qui matérialisent l’intégration des élites municipales aux pratiques romaines de spectacle et de prestige.
 Villages, villas et économie rurale
Villages, villas et économie rurale
Multiplication de villas et domaines agricoles organisés autour de la production céréalière et de l’élevage, fournissant marchés urbains et créant des centres de production concentrés ; installation d’ateliers artisanaux et de petits foyers économiques le long des voies. En effet, le territoire montre une forte implantation de fermes et de villas dispersées qui exploitent les terres de la plaine crayeuse pour les céréales, l’élevage et la production locale, en lien avec les marchés urbains et les grands domaines fonciers.
Les grands propriétaires fonciers (domini) établissent des villas de production qui structurent l’économie rurale : ce sont eux qui contrôlent la mise en culture, l’exploitation céréalière et les circuits d’approvisionnement des villes, et qui laissent le plus de traces archéologiques comme des bâtiments, ateliers, dépôts... Les magistrats municipaux, riches négociants et artisans d’Amiens forment l’ossature civique de la cité gallo romaine, finançant bâtiments publics, thermes et aménagements portuaires sur la Somme et participant activement aux échanges régionaux et transrégionaux.
Sur la côte, Itius Portus (probablement Wissant) est l'une des grandes stations navales de l'Empire romain qui y laissent de nombreuses traces de leur passage et de leur implantation, notamment les routes, appelées de nos jours " chaussées de Brunehaut ", et dont il reste quelques tronçons réconnaissables. Sept d'entre elles rayonnaient ainsi autour de Bagacum (Bavay dans l'Avesnois, dont le forum romain est fort intéressant), permettant à la cité de commercer avec tout l'empire. C'est d'ailleurs à cette époque que les principales villes se développent, parmi lesquelles Amiens, et l'explosion démographique fait des villae des cités d'importance.
L’archéologie livre des monnaies, céramiques, outils agricoles et dépôts monétaires qui renseignent sur la richesse relative et les circuits d’échange entre le Ier et le IIIe siècle après J.-C.
Conseils de lecture et visite
La romanisation a laissé des traces durables sur la toponymie, le tracé des axes, la structuration foncière et l’implantation des villes qui perdurent au Moyen Âge et modernement, formant la base du développement ultérieur de la Picardie.
Les sources écrites mentionnant des noms propres liés strictement à la Picardie romaine sont rares ; la connaissance provient surtout de l’archéologie, des inscriptions ponctuelles et de l’étude des agglomérations : Amiens, Senlis, Champlieu et des villas fouillées dans la région. Pour identifier des individus précis, il faut consulter les corpus d’inscriptions locales et les publications de fouilles régionales.
 Monuments gallo romains encore visibles en Picardie
Monuments gallo romains encore visibles en Picardie
La Picardie conserve plusieurs vestiges antiques accessibles au public, depuis des ensembles urbains à Amiens jusqu’à des sanctuaires et arènes bien conservés dans l’Oise et la Somme.
- Amiens (Samarobriva), la cité aux couches invisibles : vestiges et musées. Amiens conserve des niveaux archéologiques profonds révélant une ville-port et un nœud routier majeur de la Somme, où des fouilles urbaines ont mis au jour thermes, ateliers et abondant mobilier monétaire qui racontent la vie quotidienne et les échanges du Haut-Empire. Lors de travaux modernes, des découvertes répétées ont obligé à repenser le tracé médiéval et moderne de la cité, montrant la continuité d’occupation de Samarobriva jusqu’à nos jours. Mobilier, céramiques, monnaies sont conservé en musée. Les visiter permet de comprendre l’importance de la cité comme nœud routier et port fluvial sur la Somme pendant l’époque romaine.
- Senlis, les arènes et la mémoire des spectacle. L’amphithéâtre de Senlis reste l’un des rares vestiges publics lisibles en milieu urbain, illustrant l’importance municipale et les loisirs publics en Gaule belge. L’édifice est souvent cité dans les inventaires du patrimoine régional. Les arènes servent de repère pour comprendre la stratification urbaine. En se promenant autour, on observe comment les ruines antiques ont été réutilisées au fil des siècles pour les remparts et bâtiments médiévaux. Pourquoi visiter : l’édifice illustre l’urbanisme romain dans une cité qui a ensuite prospéré au haut Moyen Âge; facile à coupler avec la cathédrale et le centre médiéval de Senlis.
- Temple gallo romain de la forêt d’Halatte (Ognon), un sanctuaire en clairière. Le temple isolé dans une forêt témoigne des pratiques religieuses locales et du culte civique, sa rareté en contexte forestier en fait un lieu emblématique du paganisme rural gallo romain en Picardie. Classé et protégé, le site illustre la façon dont des lieux de culte païens ont parfois survécu au milieu naturel, loin des centres urbains transformés. Pourquoi visiter : rareté des temples isolés en contexte forestier et intérêt pour les cultes locaux gallo romains.
- Site de Champlieu (Orrouy / Verberie), sanctuaire, nécropole et mutation du paysage sacré. Le site de Champlieu combine vestiges d’un sanctuaire, d’un édifice religieux tardif et d’une nécropole, offrant une lecture diachronique des usages religieux et funéraires de la plaine picarde. Les fouilles ont permis d’identifier des successions d’occupations où des lieux sacrés antiques ont été réemployés ou christianisés au haut Moyen Âge, fournissant une trame d’interprétation continue pour les visiteurs. Pourquoi visiter : site archéologique majeur pour suivre la transition entre occupations militaires, religieuses et civiques sur la plaine picarde.
- Camp romain et agglomérations secondaires (ex. Vermand, Beauvais, Rue).
La Picardie livre aussi des traces militaires (camp de Vermand) et des remparts tardifs repérés à Beauvais, ainsi que des dépôts monétaires et milliers de pièces romaines découverts à Rue, qui montrent des moments de crise et de réorganisation du IIIe au IVe siècle. Des découvertes fortuites lors d’opérations d’archéologie préventive ont mis au jour des murs, habitats et sépultures urbaines, transformant parfois des projets d’aménagement en chantiers mémoire pour les communautés locales. Pourquoi visiter : pour saisir l’implantation militaire et le maillage des communications romaines dans la région.
 Musées et parcours complémentaires
Musées et parcours complémentaires
Les musées locaux et parcours thématiques rassemblent le mobilier et restituent les contextes des sites, permettant de lier objets et lieux pour raconter des vies individuelles (artisans, marchands, soldats) plutôt que des ruines abstraites. Musées à consulter : musées archéologiques locaux et musées départementaux qui présentent le mobilier issu des fouilles (Amiens, Senlis et musées départementaux).
Parcours thématiques : itinéraires « vestiges gallo romains en Picardie » recensés dans des guides et portails touristiques permettent de regrouper visites de temples, arènes et villas dispersées.
Fouilles et vestiges majeurs
Des fouilles récentes à Amiens, à Rue, à Verberie et dans d’autres sites ont mis au jour des ensembles romains riches en mobilier (monnaies, céramiques) et en structures (thermes, arènes, temples), confirmant l’importance de la présence romaine dans la région et la diversité des occupations (urbaines, militaires, rurales). Le temple gallo-romain de la forêt d’Halatte et les arènes de Senlis figurent parmi les vestiges les plus visibles et accessibles pour le visiteur.
Conseils pratiques pour le visiteur
- Visiter Amiens pour ses niveaux archéologiques, Senlis pour ses arènes et sites antiques, et consulter les publications de la Revue Archéologique de Picardie pour les monographies de fouilles permet d’approfondir la connaissance de la Picardie gallo-romaine.
- Combiner sites : regrouper Senlis et la forêt d’Halatte sur une même journée ; associer Amiens aux musées pour replacer les vestiges dans leur contexte.
- Se renseigner avant visite : certains sites sont en plein air et peuvent n’avoir que peu d’aménagements ; vérifier les horaires des musées et l’accès des sites archéologiques dans les offices de tourisme locaux.
Le Haut Moyen Âge et formation politique en Picardie
Après la chute de l’Empire romain, la Picardie entre dans la mouvance franque. Les invasions barbares aux Ve et VIe siècles ouvrirent une nouvelle ère, marquée par l’implantation franque et la naissance du royaume mérovingien autour de villes telles que Soissons, lieu emblématique du fameux « vase » attribué au roi Clovis. Des sites comme Soissons et Noyon prennent une importance politique et religieuse majeure : sacres, conciles et résidences royales y laissent une empreinte durable.
 Période mérovingienne en Picardie
Période mérovingienne en Picardie
La période mérovingienne couvre approximativement la fin du Ve siècle au milieu du VIIIe siècle et correspond en Picardie à la transition entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge, marquée par la formation des royaumes francs et la transformation des structures urbaines et rurales.
- 481- 486 : victoire de Clovis à Soissons, avec la célèbre anecdote du vase. Il fait de la ville de l'Aisne la capitale des Mérovingiens.
- 751 : Pépin le Bref est couronné roi des Francs à Soissons.
- 768 : Charlemagne est couronné roi des Francs en la cathédrale de Noyon.
- 877 : Charles le Chauve crée l'abbaye Sainte-Corneille à Compiègne.
La victoire de Clovis près de Soissons
Le combat oppose les forces franques menées par Clovis à une armée essentiellement formée d’anciens ressortissants de l’administration romaine locale et de milices liées à Syagrius ; la supériorité tactique et la cohésion des Francs permettent la rupture du dispositif adverse et la prise du terrain. Après la défaite, Syagrius fuit vers le Sud et se place sous la protection des Wisigoths à Toulouse. Alaric II remet Syagrius aux émissaires de Clovis, qui ordonne son exécution, acte qui affirme brutalement la fin de l’autorité romaine directe dans la région.
Cette victoire marque un tournant stratégique et symbolique : elle met un terme au dernier relais effectif du pouvoir impérial en Gaule et ouvre la voie à l’expansion du royaume franc sous l’égide de Clovis, posant les bases de la future monarchie mérovingienne en territoire picard et au delà. La chute de Syagrius entraîne l’annexion des territoires qu’il contrôlait, de la Loire à la Somme, à l’autorité franque. Samarobriva (Amiens) et les cités picardes entrent durablement dans l’orbite mérovingienne, modifiant l’organisation politique et fiscale du nord de la Gaule.
Installation des Francs et organisation politique
La prise de contrôle franque se concrétise par la défaite et l’arrestation du dernier « romain » local, Syagrius, lors de la victoire de Clovis près de Soissons, ce qui marque l’intégration durable de la civitas des Ambiani au royaume franc.
Réorganisation militaire et contrôle des cités
Après la conquête, les Francs s’appuient sur les anciennes cités romaines (Samarobriva/Amiens, Soissons, Senlis) pour implanter des garnisons, lever des hommes et contrôler les grandes voies. Ces centres deviennent des points de projection du pouvoir armé régional et des scènes d’affrontements entre familles aristocratiques rivales. Les Francs prennent progressivement le contrôle du territoire picard après l’effondrement de l’autorité romaine, intégrant la civitas des Ambiani à l’organisation du royaume franc et faisant de cités comme Samarobriva (Amiens) des centres d’administration régionale remodelés par les nouveaux pouvoirs.
Sociétés, économie et habitat
La Picardie mérovingienne voit une recomposition du peuplement : certaines villes se contractent tandis que des noyaux ruraux et des villae réoccupées donnent naissance à des villages proto médiévaux. L’économie reste largement agraire mais s’appuie aussi sur des réseaux d’échanges locaux entre centres de marché et relais routiers hérités de l’époque romaine.
 Églises, évêchés et christianisation
Églises, évêchés et christianisation
La christianisation s’affirme avec la consolidation des sièges épiscopaux et la construction d’églises sur des sites anciens. L’Église joue un rôle croissant dans l’encadrement social et la conservation de la mémoire locale, tandis que les pratiques chrétiennes se superposent parfois aux traditions païennes anciennes.
Guerres civiles franques et luttes entre Neustrie et Austrasie
Les Mérovingiens au pouvoir, les fils de Clovis se partagent, en 511, la Gaule en quatre morceaux. Plus tard, quand la division coupe l'empire des Francs en Neustrie et Austrasie, l'Escaut qui sépare alors la région, marque la frontière entre la Neustrie, qui deviendra la France et l'Austrasie destinée longtemps à être germanique. Après Charlemagne, le plus célèbre roi de Neustrie, les pays se transforment en comtés féodaux et un nouveau découpage modifie la donne.
Les rivalités entre maisons royales et patrimoniales entraînent des campagnes et des batailles menées en Picardie ou à sa périphérie. Impact local important sur les populations rurales et urbaines, avec sièges ponctuels de places fortes et déplacements de contingents aristocratiques. Ces conflits façonnent la géographie politique locale : renforcement de lignages locaux, mutation des sièges de pouvoir urbains et ruraux, recomposition des réseaux de fortification qui seront réutilisés au haut Moyen Âge et consignés par les chroniques et la documentation archéologique régionale.
Le contrôle des axes fluviaux (Somme) et routiers suscite la mise en place de postes de surveillance et d’actions militaires ponctuelles destinées à protéger convois et cités, traduisant l’importance stratégique de la plaine picarde dans les affrontements mérovingiens.
Fouilles, vestiges et exemples locaux
Les découvertes archéologiques récentes et les prospections aériennes ont mis au jour nécropoles mérovingiennes, habitats et éléments de mobilier funéraire en Picardie. Ces ensembles fournissent des repères chronologiques précis pour l’occupation du VIe au VIIIe siècle et illustrent la continuité et les ruptures post romaines observables sur des sites comme Vermand et autour d’Amiens. Au cours de cette période, la documentation archéologique montre des indices de militarisation locale : points fortifiés, réaménagements défensifs autour des cités, dépôts de sûreté et mouvements de population liés à la menace d’incursions ou d’hostilités internes.
La période mérovingienne en Picardie prépare la recomposition politique et sociale qui débouchera sur l’ère carolingienne. La formation de lignages locaux, la permanence de centres ecclésiastiques et la persistance d’axes routiers anciens facilitent cette transition et expliquent la pérennité de certains toponymes et structures territoriales.
Figures majeures de la période mérovingienne en Picardie
- Clovis (vers 466–511) : fondateur du royaume franc et acteur décisif en Picardie : Clovis conquiert le domaine de Syagrius en 486 près de Soissons, annexant la région qui deviendra la Picardie au royaume franc et posant les bases politiques et administratives de la domination mérovingienne dans le Nord de la Gaule.
- Syagrius (fl. 463–486) : dernier représentant de l’autorité romaine dans la région : Syagrius dirige le dernier domaine romain entre la Loire et la Somme et incarne la dernière structure de pouvoir romaine en Gaule septentrionale avant sa défaite et sa remise à Clovis, événement qui scelle la fin de l’autorité romaine effective en Picardie.
- Childéric Ier (mort 481) et lignée salienne : fondation du pouvoir franc local : Childéric Ier, chef des Francs saliens et père de Clovis, constitue la dynastie mérovingienne qui s’implante durablement dans les territoires au nord de la Loire et structure l’aristocratie militaire et territoriale qui s’affirme en Picardie.
- Pépin d’Herstal (Pépin II, mort 714) et la montée des maires du palais : La victoire de Pépin d’Herstal et la consolidation du pouvoir des maires du palais transforment l’équilibre politique du royaume franc. Leurs interventions armées et administratives au nord contribuent à la recomposition des pouvoirs locaux en Picardie et préparent la transition carolingienne.
- Dagobert Ier (r. 629–639) : figure royale d’unification et symbole d’autorité : Dagobert Ier représente une tentative d’affermir l’autorité royale sur des régions naguère fracturées; son règne illustre la persistance d’un pouvoir central capable d’agir dans les provinces du Nord et d’affirmer la prééminence royale sur les élites régionales.
- Erchinoald et chefs de la noblesse régionale, acteurs locaux influents : Des maires du palais, comtes et grands propriétaires comme Erchinoald interviennent dans les luttes de pouvoir en Neustrie et en Austrasie et commandent des contingents agissant sur le territoire picard, façonnant la géopolitique locale avant la domination carolingienne.
 Héritage et transition vers l’époque carolingienne
Héritage et transition vers l’époque carolingienne
Bataille de Tertry (687) et consolidation du pouvoir carolingien
La bataille de Tertry, livrée dans la Somme en 687, voit la victoire d’Erchinoald puis surtout de Pépin II (Pépin d’Herstal) sur les forces néo royales. Ce succès ouvre la voie à l’hégémonie des maires du palais d’Austrasie et prépare la transition politique qui conduira au pouvoir carolingien.
- 987 : le 2 juillet, couronnement de Hugues Capet à Noyon après son élection à Senlis. La dynastie des Capétiens est née !
Itinéraire recommandé pour un week end centré sur l’héritage mérovingien
- Jour 1 : visites de musées (Amiens, Soissons) pour voir le mobilier mérovingien et les expositions archéologiques.
- Jour 2 : circuit autour d’églises anciennes et de sites fouillés (cryptes, nécropoles) en liant les visites à la lecture des publications locales et panneaux d’interprétation.
Option : intégrer une halte dans un site archéologique pluridisciplinaire pour observer la superposition des occupations.
Pour aller plus loin et visiter
- La période mérovingienne a laissé peu de « grands monuments » spectaculaires en élévation ; son héritage est principalement archéologique et se manifeste par des nécropoles, des cryptes, des églises à fondations mérovingiennes et du mobilier conservé en musées.
- Consulter les collections archéologiques des musées locaux pour voir les tombes et objets mérovingiens exposés.
- Suivre les prospections aériennes et publications locales pour repérer nécropoles et sites fouillés récemment.
Le Moyen Âge en Picardie
 Un puissant foyer médiéval
Un puissant foyer médiéval
Le Moyen Âge picard est une période pendant laquelle le territoire se transforme profondément : émergence de seigneuries et de comtés, affirmation des villes et des évêchés, développement agricole et profondes ruptures lors de la guerre de Cent Ans.
Au coeur du Moyen Âge, la Picardie se structura autour de villes dynamiques et de grands domaines religieux. À la fin du XIe et au XIIe siècle, la région participe à la dynamique religieuse et intellectuelle du royaume, tandis que la féodalité structure la société locale. Les cathédrales d’Amiens, de Beauvais et de Laon témoignent de cette richesse spirituelle et artistique, faisant de la région l’un des berceaux du gothique.
Épanouissement médiéval et patrimoine gothique
Du XIIe au XIVe siècle, la Picardie devient donc un foyer important de l’architecture gothique. Cathédrales et églises à Amiens, Noyon, Beauvais témoignent d’un savoir-faire artistique et d’une vitalité économique fondée sur l’agriculture et le commerce. Les villes se fortifient, les foires et marchés prospèrent, et la région se situe à la croisée des routes entre la Flandre, l’Île-de-France et l’Angleterre.
Organisation politique et hiérarchie des pouvoirs
La Picardie se structure autour de grands pôles seigneuriaux et ecclésiastiques ; des lignages aristocratiques locaux, des comtes et des évêques exercent le pouvoir tandis que des marches et domaines (notamment au sud de l’Aisne et dans l’Oise) présentent une grande diversité institutionnelle au sein du territoire picard. À partir du XIe siècle, l’affirmation des seigneurs locaux coexiste avec la montée en puissance des villes et l’emprise croissante du droit féodal sur la population rurale.
Culture, religion et héritage patrimonial
L’Église avec les évêchés, les abbayes, les ordres religieux joue un rôle central dans l’alphabétisation, la conservation des archives et la structuration du paysage rural et urbain. Les pratiques rituelles, les pèlerinages et les fêtes locales animent la vie sociale. Les fouilles et synthèses régionales permettent aujourd’hui de reconstituer la diversité des pratiques funéraires, la matérialité des élites et la culture matérielle des paysans picards, documents indispensables pour toute visite ou mise en valeur touristique.
Société, peuplement et économie rurale
La Picardie médiévale reste majoritairement rurale : la structure du peuplement se transforme avec la fixation des villages, l’essor des terroirs ouverts à la culture céréalière, et une organisation paysanne marquée par la manorialisation et la présence de nombreux cimetières et habitats dispersés. Les études récentes sur les campagnes montrent une mosaïque de situations locales et une forte variabilité entre les plaines du Ponthieu, la vallée de la Somme et les marges méridionales.
Villes, commerce et patrimoine monumental
Les villes picardes d'Amiens, Beauvais, Senlis, Saint Quentin, Laon en proche périphérie se développent comme centres administratifs, marchands et religieux. Elles investissent massivement dans l’architecture gothique : cathédrales, beffrois, halles, qui donne à la Picardie l’un des paysages urbains médiévaux les plus remarquables de France. L’essor urbain s’appuie sur des foires, le commerce du sel et des céréales, et des réseaux de communication hérités de l’Antiquité.
Dates et épisodes clefs
Au milieu du XIe siècle Guillaume le Conquérant consolide son pouvoir en Normandie tout en cherchant des alliés et des bases pour une offensive outre Manche. La baie de Somme offre des mouillages protégés, des points d’approvisionnement et des relais pour les navires quand les conditions en Manche se dégradent. Entre 1050 et 1066, la région sert d’escale diplomatique et logistique pour la flotte normande, contribuant aux manœuvres d’embarquement et aux accords locaux nécessaires au grand projet d’invasion.
 Années 1050–1053 : présences normandes répétées sur la côte picarde pour affaires politiques et militaires.
Années 1050–1053 : présences normandes répétées sur la côte picarde pour affaires politiques et militaires.- 1053 : épisode fameux autour de Saint Valery sur Somme où Harold (futur roi d’Angleterre) est, selon certaines traditions locales et sources postérieures, détenu un temps dans la tour dite « d’Harold » avant d’être rendu à Guillaume. Cet épisode entre dans la chronologie complexe des relations anglo nor mando franches.
- 1066 : période de préparation et d’embarquement pour l’invasion de l’Angleterre. La baie de Somme, ses abords et ports comme Saint Valery et Le Crotoy servent de points d’escale et de ravitaillement pendant les manœuvres de navigation, la construction et l’amarrage d’une partie de la flotte normande.
- Étés 1066 (retards météo) : intempéries en Manche et vent défavorable contraignent Guillaume à différer ses départs et à profiter des abris naturels de la baie pour préparer l’embarquement, augmentation de la logistique et contrôle des points de passage côtiers.
La navigation du XIe siècle dépend fortement des vents et des marées. Les intempéries et les vents contraires peuvent retarder une armée navale plusieurs jours voire semaines. La morphologie de la baie de Somme, ses bancs de sable et ses estuaires en font un refuge précieux lorsque la Manche est capricieuse. Les préparatifs à Saint Valery et au Crotoy impliquent stockage de vivres, ajustement des embarcations et coordination des équipages, autant d’opérations concrètes qui expliquent la présence prolongée de contingents normands dans la zone avant l’hiver 1066.
Les historiens discutent l’importance stratégique réelle de la baie de Somme pour l’embarquement final de 1066 ; la Manche et les ports normands restent centraux, la baie ayant servi plutôt d’escale et de lieu de rassemblement secondaire. La tradition locale a fortement contribué à construire la légende du passage de Guillaume. Entre éléments factuels, interpolations postérieures et héritage littéraire (y compris des sources anglo normandes), les historiens confrontent récit et preuve matérielle. La baie reste néanmoins essentielle pour comprendre la logistique médiévale : prospections, archives portuaires et panneaux d’interprétation complètent les sources littéraires pour proposer une vision nuancée des événements.
- 1145 : début de l'ère des cathédrales en Picardie, avec les travaux de construction de la plus ancienne d'entre elles, Noyon.
L'histoire de la région de la Picardie au Moyen Age reflète la complexité du système féodal. A l'ouest, le comté de Flandre profite d'un pouvoir royal français trop lointain. Positionné comme un vassal théorique du roi de France, ce comté occupera une position particulière. Les premiers comtes flamands, qui émergent, étendent leur juridiction de la Canche à l'embouchure de l'Escaut. Du côté germanique, on observe la même tendance avec l'apparition d'entités politiques ne devant qu'une obéissance toute théorique à l'empereur.
En 1180, Isabelle de Hainaut épousa Philippe Auguste, qui reçut donc l'Artois en dot. En 1186 : le traité de Boves partage la Picardie entre le roi et la Flandre. Suite à une succession délicate concernant le comté de Flandre et impliquant le comté de Hainaut, le roi de France doit faire face à une coalition réunissant l'empereur, le roi d'Angleterre et le comte de Flandre (Ferrand de Portugal). L'affrontement se solde par une bataille décisive à Bouvines en 1214, laquelle voit la victoire de Philippe Auguste. De ce fait, Philippe Auguste parvint à donner aux rois de France la possibilité de peser sur les affaires des Flandres et du Hainaut. Cette période profite également à l'émergence religieuse, où fleurissent les béguinages. Néanmoins, cette période faste est de courte durée. Les tensions montent progressivement entre les rois de France et d'Angleterre, au sujet des Flandres notamment. Le comte de Flandre est au service de son suzerain le roi de France, alors que les intérêts économiques des Flamands sont tournés vers l'Angleterre. Quant au comte de Hainaut, c'est tout naturellement qu'il se range du côté de l'empereur, lequel est allié à l'Angleterre.
C'est alors qu'éclate la guerre de Cent Ans, très éprouvante pour la région, devenue véritable champ de bataille et enjeu des royaumes.
Conflits, crises et la guerre de Cent Ans
La position géographique de la Picardie la place au cœur des conflits franco anglais et des chevauchées entre XIVe et XVe siècles. La Picardie est un territoire stratégique : plaines ouvertes, axes routiers et estuaires en font un terrain d’opérations privilégié.La guerre de Cent Ans se traduit en Picardie par une longue suite d’incursions, de batailles ponctuelles, d’occupations et de mises en défense des villes. Les phases majeures qui affectent directement la région sont : les chevauchées et débarquements anglais du XIVe siècle, la bataille de Crécy et ses conséquences (1346), les années d’occupation partielle et d’instabilité au tournant des XIVe–XVe siècles, les campagnes d’Henry V et leurs effets en 1415–1420, puis la reprise progressive par les armées françaises au XVe siècle jusqu’à la consolidation du pouvoir royal.
La guerre de Cent Ans provoque ravages, sièges, et déplacements de population, obligeant villes et campagnes à se fortifier, à négocier redditions et traités, et à gérer des crises démographiques et économiques profondes. Au-delà des combats, la région dut également faire face aux épidémies, notamment celle de peste noire.
Les « routiers » et compagnies libérées à la trêve ou après contrats militaires pèsent fortement sur la sécurité des campagnes, entraînant formation de milices municipales et renforcement des péages/fossés. Certains villages sont abandonnés, les cultures incendiées ou réquisitionnées, famines locales et exode partiel des populations sont courantes. Certaines villes renforcent leurs libertés et leurs propres armées municipales pour se défendre et négocier maintiens et privilèges avec rois ou capitaines d’armée. De nombreuses cités préfèrent négocier rançon ou capituler assorties de conditions plutôt que subir un siège prolongé.
Fortification des villes, les remparts sont renforcés, tours de guet, reconstruction d’enceintes urbaines, creusement de fossés et installation de barbicanes pour résister aux sièges et aux tirs d’artillerie naissante. Les seigneurs multiplient ou restaurent les places castrales ; plusieurs châteaux médiévaux de la région sont consolidés, transformés, parfois démantelés puis reconstruit au gré des occupations. À partir du XVe siècle l’usage de bombarde et du canon modifie progressivement la défense des villes et entraîne des modifications dans les murailles et la tactique de siège.
Événements militaires marquants
La bataille de Crécy (1346). Affrontement décisif entre l’armée anglaise d’Édouard III et l’armée française, marquant la supériorité tactique anglaise (archers, position défensive) et entraînant de lourdes pertes pour les chevaliers français. Conséquences locales : pillages et terreur dans la région du Ponthieu, renforcement de garnisons anglaises et renversement temporaire des équilibres de pouvoir. La bataille de Crécy marque un tournant tactique et symbolique. L’armée anglaise d’Édouard III impose sa supériorité grâce à l’emploi massif d’archers à pied et à une position défensive avantageuse. L’humiliation subie par la chevalerie française et la déroute qui s’ensuit entraînent pillages et instabilité dans la région.
 Les chevauchées et occupations successives (XIVe–début XVe). Raids rapides visant à dévaster campagnes, prendre rançon et affaiblir l’adversaire économique. Impact : dépeuplement, abandon de terres, multiplication des dépôts de sûreté et des fortifications rurales; apparition et prolifération des compagnies de mercenaires en quête de butin. Tout au long du XIVe siècle, la tactique de la chevauchée ravage les campagnes picardes. Les villages sont pillés, les cultures mises à feu et la population rurale se déplace ou se fortifie. Les compagnies de routiers se multiplient, transformant la paix relative en insécurité permanente.
Les chevauchées et occupations successives (XIVe–début XVe). Raids rapides visant à dévaster campagnes, prendre rançon et affaiblir l’adversaire économique. Impact : dépeuplement, abandon de terres, multiplication des dépôts de sûreté et des fortifications rurales; apparition et prolifération des compagnies de mercenaires en quête de butin. Tout au long du XIVe siècle, la tactique de la chevauchée ravage les campagnes picardes. Les villages sont pillés, les cultures mises à feu et la population rurale se déplace ou se fortifie. Les compagnies de routiers se multiplient, transformant la paix relative en insécurité permanente.
Les campagnes d’Henry V et l’hiver 1415–1420. Flux de troupes et de convois anglais traversant ou campant sur les plaines, pressions sur les villes, réquisitions et renforcement des défenses urbaines. Les offensives anglaises entre 1415 et 1420 entraînent une nouvelle vague d’occupations et de réquisitions. Certaines villes tombent ou doivent composer avec les garnisons anglaises, la région servant de base pour les opérations vers le nord et l’ouest.
La capture de Jeanne d’Arc (1430) et son lien avec la région. Compiègne, ville stratégique en bordure de la Picardie historique, devient le point de bascule où la campagne de Jeanne tourne à la tragédie, illustrant la porosité des frontières militaires dans la région.
À partir des années 1429–1450 la France reprend progressivement l’initiative. Actions militaires, reconquêtes et traités restaurent l’autorité royale, mais la reconstruction est longue et coûteuse pour les communautés locales. L’arrestation de Jeanne d’Arc en 1430 lors d’une sortie de Compiègne illustre la porosité du front et la vulnérabilité des places. Cet épisode, bien que ponctuel, a des répercussions symboliques majeures sur la résistance française.
Les négociations et traités conclus en territoire picard ou limitrophe
Traité de Picquigny (1475) : bien qu’il intervienne après la fin conventionnelle de la guerre, il scelle des arrangements entre souverains et marque la fin des dernières prétentions anglaises visibles dans la région, acte symbolique où la Picardie sert de cadre diplomatique.
Rattachée progressivement au domaine royal, la Picardie resta pourtant une zone frontalière très disputée entre le royaume de France, la Bourgogne et plus tard les Habsbourg. Les forteresses, châteaux et villes fortifiées s’y multiplièrent, illustrant son rôle dans les rivalités européennes.
Chronologie
- 1328 : le roi de France, Charles IV, meurt sans héritier. Philippe de Valois s'installe sur le trône pourtant revendiqué par Édouard III d'Angleterre.
- 1337 : début de la guerre de Cent Ans qui va profondément marquer la Picardie et commencer une série de guerres en Picardie. Philippe de Valois récupère Guyenne et Ponthieu à son vassal anglais qui déclenche le conflit et commence par saccager l'Aisne de Saint-Quentin à Laon.
- 26 août 1346 : la France est défaite par les Anglais lors de la célèbre bataille de Crécy, à Crécy-en-Ponthieu. Les archers gallois défont la bourgeoisie de la Somme.
- 1360 : un traité entre le dauphin Charles V et Édouard III redonne une partie de la France à l'Angleterre, notamment le Ponthieu.
- XVe siècle : la Picardie est écartelée, même si elle est majoritairement anglo-bourguignonne !
Philippe le Bon, duc de Bourgogne de 1419 à 1467, par d'incessantes manoeuvres matrimoniales, met un terme définitif aux comtés de Flandre et de Hainaut et réunit sous sa couronne la totalité de ce qu'on appelle alors les Pays-Bas. Dans la continuité, Charles le Téméraire entreprit de doter ses seigneuries d'institutions communes. Cette période est d'une relative prospérité.
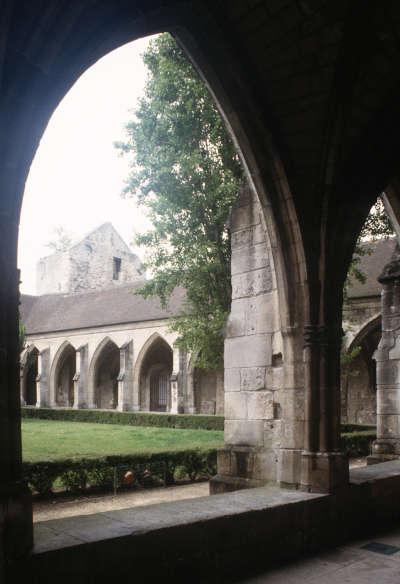 18 août 1429 : après l'avoir conduit au sacre à Reims, Jeanne d'Arc emmène le roi de France Charles VII à Compiègne où il fait une entrée solennelle.
18 août 1429 : après l'avoir conduit au sacre à Reims, Jeanne d'Arc emmène le roi de France Charles VII à Compiègne où il fait une entrée solennelle.- 23 mai 1430 : Jeanne d'Arc est capturée par les Anglais à Margny-lès-Compiègne et est transférée à Rouen, via Saint-Valery-sur-Somme, pour y être jugée puis brûlée.
- 1435 : le traité d'Arras marque la fin de la guerre entre les Bourguignons de Philippe le Bon et la « France de France » de Charles VII.
- 1461 : le conflit franco-bourguignon, qui a quelque peu supplanté la guerre entre l'Angleterre et la France, du moins en Picardie, reprend vivement entre les deux descendants, Charles le Téméraire, fils de Philippe le Bon, et Louis XI, fils de Charles VII.
- 1468 : Louis XI est à Péronne pour tenter une alliance avec Charles le Téméraire. Le Bourguignon capture finalement le roi de France et le libère sous conditions. Mais Louis XI reniera sa promesse...
- 1472 : pour se venger, Charles le Téméraire s'attaque à nouveau à la Picardie avec 30 000 hommes. Il détruit Nesle et marche sur Beauvais, défendue par l'héroïne Jeanne Hachette.
- 29 août 1475 : l'Angleterre et la France signent le traité de Picquigny, village de la Somme qui met fin à la guerre de Cent Ans. Édouard IV l'Anglais préfère mettre un terme au conflit plutôt que de s'allier à nouveau avec Charles le Téméraire le Bourguignon.
- 1483 : la fille de Charles le Téméraire se marie avec un Habsbourg qui signe la paix d'Arras, faisant entrer la Picardie dans le royaume de France.
Lieux de mémoire et visites recommandées en lien avec la guerre de Cent Ans
- Champ de bataille de Crécy en Ponthieu : mémorial et interprétation du site.
- Compiègne : musées et parcours rappelant la capture de Jeanne d’Arc et la dynamique militaire de la zone.
- Péronne (Musée de la Somme / Château Musée) : collections pluridisciplinaires retraçant occupations et conflits, utile pour replacer la guerre médiévale dans une longue durée régionale.
- Remparts et centres historiques (Amiens, Senlis, Beauvais) : observer les traces de remaniements défensifs médiévaux.
- Picquigny : site du traité homonyme et paysages pour comprendre la géographie stratégique des négociations.
La guerre de Cent Ans a laissé en Picardie un patrimoine de pierres et de mémoires, un paysage transformé par la violence et la résistance, et des récits humains puissants. Cet ensemble nourrit aujourd’hui circuits de découverte et musées qui permettent de comprendre comment une longue guerre peut remodeler durablement une région.
Itinéraire conseillé en Picardie
Itinéraire sur 2 jours centré sur Crécy, Compiègne et Picquigny pour lire la guerre dans le paysage et les musées
- Jour 1 Crécy en Ponthieu et Péronne
Matin : visite du site de la bataille de Crécy pour comprendre la topographie du combat et le rôle des archers.
Après midi : déplacement à Péronne, visite du château musée pour situer la région dans la longue durée des conflits et consulter expositions sur fortifications et société médiévale.
- Jour 2 Compiègne et Picquigny
Matin : visite de Compiègne pour retracer la capture de Jeanne d’Arc et observer remparts et vestiges castraux. Musées locaux pour mobilier et documents d’archives.
Après midi : halte à Picquigny pour lire le site du traité de 1475 et appréhender la géographie stratégique des négociations de fin de conflit.
De la Renaissance à la Révolution
 En 1506, Charles de Gand hérite de son père ce que l'on appelle alors les Pays-Bas. Elu empereur du Saint-Empire et roi d'Espagne connu sous le nom de Charles Quint, il entreprend sans difficulté de grandes réformes administratives. Pendant les cent cinquante ans qu'ils furent soumis à la domination espagnole, l'Artois et la Flandre, du fait de leur richesse et de leur position stratégique, ont réussi à se faire accorder des privilèges importants, qu'ils conserveront après leur retour à la Couronne de France. D'inévitables tensions territoriales éclatent régulièrement avec le royaume de France, dont la frontière s'arrête encore à l'Aisne. L'affrontement légendaire entre Charles Quint et François Ier se fait durement ressentir dans la région : les bourgs sont pris et rasés. Seul le Cambrésis, positionné en duché, reste une terre neutre qui permettra les discussions entre les belligérants.
En 1506, Charles de Gand hérite de son père ce que l'on appelle alors les Pays-Bas. Elu empereur du Saint-Empire et roi d'Espagne connu sous le nom de Charles Quint, il entreprend sans difficulté de grandes réformes administratives. Pendant les cent cinquante ans qu'ils furent soumis à la domination espagnole, l'Artois et la Flandre, du fait de leur richesse et de leur position stratégique, ont réussi à se faire accorder des privilèges importants, qu'ils conserveront après leur retour à la Couronne de France. D'inévitables tensions territoriales éclatent régulièrement avec le royaume de France, dont la frontière s'arrête encore à l'Aisne. L'affrontement légendaire entre Charles Quint et François Ier se fait durement ressentir dans la région : les bourgs sont pris et rasés. Seul le Cambrésis, positionné en duché, reste une terre neutre qui permettra les discussions entre les belligérants.
Chronologie
- 1519 : la paix avec les Habsbourg ne dure pas longtemps. Charles Quint devient empereur et fait preuve d'une ambition démesurée pour agrandir son territoire au sud des Pays-Bas qu'il domine.
- 15 août 1539 : François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui fait du français la langue de référence dans le royaume.
- 1540-1550 : François Ier construit de nombreuses forteresses en Picardie.
- 1557 : terrible bataille à Saint-Quentin entre Philippe II, qui succède à Charles Quint comme roi d'Espagne, et Henri II, le fils de François Ier. Noyon est également ravagée.
Mais les batailles continuent à d'autres niveaux. De fortes oppositions religieuses se font sentir. Le protestantisme cherche à s'installer dans la région et pour faire face à ce mouvement, l'Université de Douai est installée par la contre-réforme catholique, en 1552.
Les guerres de Religion en Picardie
 La Picardie entre dans les guerres de Religion dès les années 1560 et connaît une succession d’épisodes violents, d’épurations religieuses et de négociations locales qui s’inscrivent dans les huit guerres nationales (1562–1598). Les années 1562–1563 marquent l’escalade initiale dans la région, suivies de vagues répressives, de reprises d’hostilités et d’un milieu social largement militarisé jusqu’à la fin du XVIe siècle.
La Picardie entre dans les guerres de Religion dès les années 1560 et connaît une succession d’épisodes violents, d’épurations religieuses et de négociations locales qui s’inscrivent dans les huit guerres nationales (1562–1598). Les années 1562–1563 marquent l’escalade initiale dans la région, suivies de vagues répressives, de reprises d’hostilités et d’un milieu social largement militarisé jusqu’à la fin du XVIe siècle.
Période d’escalade (années 1560)
Affrontements périurbains et premières vagues d’exactions, polarisation confessionnelle des élites municipales et des seigneuries locales.
Radicalisation et épuration (vers 1562–1563 et récurrences ultérieures)
Episodes d’« extermination » ciblée contre des communautés huguenotes locales et violences collectives documentées dans plusieurs cantons picards.
Les massacres et l’« extermination » de 1562 (Amiens et environs)
En juillet 1562, Amiens et sa région vivent des opérations de répression concertées contre les protestants, qualifiées par certaines sources locales et études récentes d’« extermination » : arrestations, exécutions sommaires et purges orchestrées par des autorités municipales et ecclésiastiques alliées à des groupes armés, provoquant des départs massifs et la disparition de réseaux huguenots locaux.
Conflits urbains et luttes de pouvoir (Senlis, Amiens, Beauvais)
Les villes picardes deviennent des scènes de lutte entre factions catholiques et protestantes. Senlis et Amiens connaissent des épisodes de contrôle alterné, sièges internes, saisies d’édifices religieux et règlement de comptes municipaux qui transforment les administrations municipales en instruments de répression et de défense confessionnelle.
 Les batailles sanglantes se succèdent, si bien que les provinces du Nord des Pays-Bas espagnols, pour la plupart protestantes et néerlandophones, rejettent le roi d'Espagne et constituent les Provinces-Unies en 1581. Les Pays-Bas méridionaux restent, eux, catholiques, qui dépendent d'un empire plus vaste, dirigé (depuis Madrid) par les Habsbourg. La fin d'une époque est signée.
Les batailles sanglantes se succèdent, si bien que les provinces du Nord des Pays-Bas espagnols, pour la plupart protestantes et néerlandophones, rejettent le roi d'Espagne et constituent les Provinces-Unies en 1581. Les Pays-Bas méridionaux restent, eux, catholiques, qui dépendent d'un empire plus vaste, dirigé (depuis Madrid) par les Habsbourg. La fin d'une époque est signée.
La Picardie a été fortement touchée par les guerres de Religion, qui y ont pris des formes locales parfois violentes et durables, mêlant affrontements armés, purges anti protestantes et luttes de pouvoir entre seigneurs, villes et autorités ecclésiastiques. Plusieurs procès, plaintes et dossiers notariaux conservent la trace d’exactions collectives (saisies de biens, dépositions pour meurtres politiques, confiscations). Ces archives montrent l’imbrication de la justice municipale et des enjeux confessionnels, et expliquent la recomposition sociale locale après les violences (exils, remplacements de notables, confiscations de patrimoines).
Chronologie
- 1562-1598 : les guerres de Religion vont à nouveau plonger la Picardie dans la terreur.
- 1589 : Henri de Navarre, pour devenir roi de France, devient Henri IV. Il fait reconstruire les remparts de Crépy. Les guerres de Religion cessent avec l'édit de Nantes.
- 1598 : la paix de Vervins met fin à la guerre avec l'Espagne entre Henri IV et Philippe II.
- 1618-1648 : la guerre de Trente Ans oppose à nouveau Espagnols et Français.
Guerres et reconstructions : une terre meurtrie par les conflits
- 7 novembre 1659 : la paix des Pyrénées réintègre la Picardie dans le royaume de France et repousse la zone frontière.
Les guerres de conquête de Louis XIV font fi des comtés et dessinent alors à peu près les frontières du nord de la France telles qu'elles sont aujourd'hui. Après avoir annexé l'Artois en 1659 et racheté Dunkerque aux Anglais, Louis XIV s'empare de Douai et de Lille en 1667, puis de Valenciennes et Cambrai en 1677. Le roi impose sa nouvelle administration, tandis que Vauban métamorphose le système défensif médiéval imposant plusieurs villes fortifiées, qui marquent profondément le paysage de la région.
La Révolution française en Picardie
 Les montées des revendications et la révolution ont un impact significatif sur la région. La Révolution française transforme profondément la Picardie entre 1789 et la fin du XVIIIe siècle en mêlant soulèvements populaires, réformes administratives et affrontements politiques locaux. Les débats pré révolutionnaires sur la représentation, les impôts et les privilèges y sont vifs, portés par notables, juristes et assemblées locales qui préparent la crise nationale.
Les montées des revendications et la révolution ont un impact significatif sur la région. La Révolution française transforme profondément la Picardie entre 1789 et la fin du XVIIIe siècle en mêlant soulèvements populaires, réformes administratives et affrontements politiques locaux. Les débats pré révolutionnaires sur la représentation, les impôts et les privilèges y sont vifs, portés par notables, juristes et assemblées locales qui préparent la crise nationale.
La Constituante de 1790 donne naissance aux départements. Les discussions sont âpres sur les partages. La Révolution française bouleverse les institutions locales, réorganise les circonscriptions et transforme le paysage politique et social.
Les événements de 1789 et les mouvements populaires
À l’été et l’automne 1789, la région connaît mobilisations de notables et du tiers état dans les villes (états provinciaux, cahiers de doléances), manifestations urbaines et saisies de biens seigneuriaux dans les campagnes, avec des épisodes de colère anti seigneuriale et de restructuration des rapports de propriété hérités de l’Ancien Régime.
Réorganisation administrative et naissance des départements
La disparition des provinces et la création des départements en 1790 réorganisent la Picardie : les anciennes circonscriptions provinciales sont remplacées par les départements actuels (Somme, Oise, Aisne), ce qui modifie durablement l’échelle de l’administration, de la justice et de la fiscalité locale et redéfinit les centres de pouvoir régionaux.
Anti cléricalisme, confiscations et déchristianisation
La politique révolutionnaire touche très directement le paysage religieux picard : nationalisation des biens du clergé, ventes des biens nationaux, application de la Constitution civile du clergé et, pendant les phases les plus radicales, actes de destruction ou de mise à l’écart d’objets et de monuments religieux dans certaines paroisses. Des réactions locales tentent parfois de protéger statues et tombeaux, comme l’illustrent témoignages et reportages régionaux sur les destructions d’églises et la sauvegarde partielle d’œuvres.
Conflits locaux, résistance et recompositions sociales
La mise en place du nouveau régime provoque des tensions : prêtres réfractaires et fidèles hostiles à la Constitution civile entrent en conflit avec autorités municipales et patriotes; des procès, plaintes et mobilisations se multiplient; la vente des biens nationaux fait émerger de nouveaux propriétaires et bouleverse les équilibres seigneuriaux et fonciers locaux, favorisant parfois l’essor d’une petite propriété paysanne ou l’implantation de nouveaux notables révolutionnaires.
Figures clés liées à la Picardie pendant la Révolution française
François Noël Babeuf (Gracchus Babeuf) : agitateur populaire et théoricien égalitariste ; né et formé en Picardie, il incarne les aspirations radicales de la fin des années 1790 et la conjuration dite « du Compromis » qui préfigure les débats sur égalité sociale.
François Noël Babeuf dit Gracchus Babeuf naît en 1760 à Saint Quentin. Formé dans les métiers du cadastre et de la petite administration locale, il connaît tôt l’expérience de la misère et des injustices fiscales qui nourrissent sa radicalisation. Pendant la Révolution il oscille entre carrière administrative et action politique : journaliste, pamphlétaire et organisateur, il devient l’un des porte voix les plus intransigeants de l’égalité révolutionnaire.
Babeuf se fait connaître par ses écrits et son journalisme populaire. Opposé aux modérés et critique virulent du Directoire, il imagine une réforme sociale radicale visant la suppression des inégalités économiques structurelles. Après l’effondrement du régime jacobin et la crise économique des années 1794–1795, il fonde la Société des Égaux et prépare ce qu’on appellera la Conjuration des Égaux : projet d’insurrection destiné à imposer un partage égalitaire des terres et des moyens de subsistance.
Sa démarche combine une rhétorique héritée des Lumières et une radicalité nouvelle : critique des privilèges, revendication d’un droit de propriété transformé, volonté d’une régulation collective de la production et des distributions. Capturé à l’automne 1796, il est jugé et exécuté en 1797. Sa disparition n’a pas tari l’influence de ses idées : il devient un symbole pour les courants égalitaires postérieurs et inspire des débats sur la propriété, l’égalité économique et les limites de la répression politique.
Lieux de mémoire et sources locales : Saint Quentin, Roye et les archives départementales — conservent traces de son enfance, de ses premières activités et de la réception de ses écrits. Son héritage est double : figure d’un radicalisme républicain et matrice d’un discours égalitaire qui traversera le XIXe siècle.
 Nicolas de Condorcet : philosophe, député et réformateur des Lumières; origines familiales picardes et action parlementaire nationale qui influencent les débats sur l’instruction publique et les droits civils durant la Révolution.
Nicolas de Condorcet : philosophe, député et réformateur des Lumières; origines familiales picardes et action parlementaire nationale qui influencent les débats sur l’instruction publique et les droits civils durant la Révolution.
Nicolas de Condorcet naît en 1743 à Ribemont en Picardie et se construit comme l’un des esprits les plus représentatifs des Lumières. Mathématicien et philosophe, il se distingue par ses travaux sur les probabilités et par une vision politique progressiste fondée sur la raison, l’éducation et le progrès moral de l’humanité. Il occupe des postes académiques et se lie aux principaux réseaux intellectuels parisiens tout en conservant des attaches picardes.
Politiquement, Condorcet intervient vigoureusement pendant la Révolution. Siégeant comme député et affilié aux positions girondines modérément réformatrices, il plaide pour l’instruction publique universelle, la liberté de la presse, l’abolition progressive des privilèges et une justice plus rationnelle. Son fameux « Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain » synthétise sa croyance au progrès indéfini des connaissances et des droits.
Condorcet demeure également un critique des excès révolutionnaires. Persécuté sous la Terreur, il tente la clandestinité et meurt en 1794 dans des circonstances troubles alors qu’il cherchait à rejoindre des refuges. Son épouse Sophie de Grouchy et ses correspondances contribuent à la diffusion de sa pensée.
En Picardie les lieux liés à Condorcet ; Ribemont, certains fonds d’archives départementales, conservent documents et correspondances illustrant ses projets pédagogiques et ses interventions politiques. Son influence se retrouve dans l’héritage éducatif républicain et dans la réflexion sur les institutions démocratiques modernes.
Pierre Choderlos de Laclos : officier et écrivain originaire d’Amiens; figure littéraire et militaire dont le parcours illustre les circulations sociales et culturelles entre Picardie et les centres révolutionnaires.
Camille Desmoulins : journaliste et tribun révolutionnaire; d’origine picarde, ses appels et sa plume participent à la mobilisation populaire et aux débats politiques qui secouent les villes de province comme celles de Picardie.
Antoine Quentin Fouquier Tinville : procureur révolutionnaire associé à l’appareil judiciaire parisien mais dont les réseaux et origines provinciales font écho aux répercussions judiciaires de la Terreur sur les provinces y compris la Picardie.
Personnalités municipales et ecclésiastiques locales — maires, officiers municipaux, procureurs syndicaux, curés « patriotes » et réfractaires qui, à l’échelle des villes picardes (Amiens, Saint Quentin, Beauvais, Senlis), jouent un rôle décisif dans l’application des décrets révolutionnaires, la vente des biens nationaux et les conflits religieux et sociaux.
Notables révolutionnaires locaux — députés aux États généraux et représentants en mission issus de la Picardie qui participent aux assemblées départementales et nationales, orchestrent les réformes administratives et gèrent les tensions locales (création des départements, levées, réquisitions).
 Monuments et sites républicains à visiter en Picardie
Monuments et sites républicains à visiter en Picardie
La Révolution a laissé en Picardie des traces visibles (ventes de biens nationaux, réemplois dans les bâtiments communaux, cimetières transformés) et des archives riches (cahiers de doléances, registres des ventes nationales, correspondances municipales) conservées dans les archives départementales et municipales; pour l’étude des destructions et des sauvegardes d’œuvres religieuses, les dossiers audiovisuels et études locales offrent des cas concrets de protection ou de perte du patrimoine.
Amiens pendant la Révolution
Amiens occupe un rôle exemplaire pour lire les mutations révolutionnaires en province. À la veille de 1789 la ville combine notables urbains, une administration municipale active et une bourgeoisie commerçante qui jouent un rôle moteur dans la rédaction des cahiers de doléances. L’année 1789 voit la mobilisation du tiers état amiénois, la formation d’assemblées municipales et des débats vifs sur la représentation et les impôts.
La Révolution transforme profondément le paysage religieux et foncier d’Amiens. La nationalisation des biens du clergé (1789–1790) provoque ventes massives, recomposition de la propriété urbaine et mutation des usages d’espaces religieux. La mise en place de la Constitution civile du clergé divise la population : curés « assermentés » et prêtres réfractaires entrent en conflit, entraînant tensions locales, procès et parfois violences symboliques autour des églises.
Politiquement Amiens voit l’émergence de figures municipales révolutionnaires, l’affirmation de clubs et sociétés populaires, puis des reflux lors des phases thermidoriennes. La ville sert aussi de centre d’administration départementale après la création des départements, ce qui recentre décisions fiscales et judiciaires et modifie les circuits de pouvoir.
Sur le plan social les ventes des biens nationaux ouvrent l’accès à la propriété pour des artisans et commerçants urbains, mais provoquent aussi spéculations et résistances. Les archives municipales et départementales conservent registres de vente, procès verbaux de sections et correspondances qui permettent de retracer la matérialité de la Révolution : listes de propriétaires, inventaires d’églises, et comptes rendus de réunions publiques.
Musées et maisons natales (patrimoines biographiques)
Maison natale ou lieux de mémoire liés à Condorcet et Babeuf : musées locaux et panneaux d’interprétation conservent souvenirs, portraits et dossiers biographiques. Ces lieux servent d’entrée pour comprendre les parcours individuels au cœur de la Révolution.
Musées départementaux (collections d’archives et objets révolutionnaires) : grands musées régionaux rassemblent registres, inventaires de biens nationaux et mobilier saisi pendant la période.
Églises, paroisses et traces des destructions révolutionnaires
Églises et cryptes où l’on observe traces de dépôts, réemplois et interventions révolutionnaires ; panneaux et dossiers locaux relatent les campagnes de déchristianisation et les opérations de sauvegarde (témoignages de la fin du XVIIIe siècle).
Sites administratifs et lieux de vente des biens nationaux
Anciennes maisons d’administration municipale, sièges d’assemblées de section et lieux de vente des biens nationaux en centre ville (Amiens, Senlis, Saint Quentin) : suivre les circuits urbains pour repérer bâtiments réutilisés après 1789 et plaques commémoratives qui expliquent la recomposition foncière et sociale.
Avant même que n'éclate la Révolution française, la Révolution brabançonne, qui refusait les réformes de Joseph II d'Autriche, éclatait sur les frontières de nos régions, qui mena à l'indépendance des Etats Belgiques unis en 1790. La même année, l'Assemblée législative déclarait la guerre à l'Autriche et les armées françaises se réunissaient en Flandre pour se rendre maîtres des Pays-Bas et révolutionner la Belgique. Les premières opérations ne furent pas heureuses. Pourtant, le siège infructueux de Lille par le duc de Saxe montra l'héroïsme des Lillois et redoubla l'enthousiasme qu'inspiraient alors les luttes d'une seule nation contre toutes pour sa liberté. Les Français perdirent un temps Landrecies, Le Quesnoy, Condé et Valenciennes, qui furent incorporés à la Belgique. Cependant, la campagne française se solda par l'occupation des provinces bataves.
Chronologie
- 1789-1815 : la Révolution française et ses Picards (Babeuf, Camille Desmoulins).
- 27 mars 1802 : signature de la paix d'Amiens entre l'Angleterre et la France.
- 1870 : guerre avec la Prusse ; les villes sont occupées par l'envahisseur.
- 1885 : Viollet-le-Duc, grand architecte, restaurateur notamment des cathédrales Notre-Dame de Paris et d'Amiens, achève la rénovation du château de Pierrefonds.
L’époque napoléonienne en Picardie
Entre 1799 et 1815 la Picardie connaît une double transformation : la mise en œuvre durable des réformes administratives et juridiques napoléoniennes, et la contrainte répétée des guerres impériales qui mobilisent hommes, ressources et territoires. Ce texte propose un panorama thématique suivi d’un petit circuit patrimonial pour lire sur le terrain les traces de l’Empire. La période napoléonienne en Picardie se caractérise par la combinaison d’une profonde normalisation administrative et juridique, et d’une forte contrainte militaire et sociale due aux guerres : départs massifs de conscrits, réquisitions, perturbation des économies locales et traces durables dans le paysage administratif et foncier.
 Sous le Premier Empire, la Flandre cessa d'être le théâtre de la guerre. Elle avait accueilli avec peu d'empressement les idées révolutionnaires, sans toutefois y opposer une réelle résistance. Mais elle avait fourni d'excellents soldats et continua d'en donner aux armées de Napoléon. En 1814, ses villes furent assiégées et, après les Cent Jours, la région subit l'occupation et perdit quelques districts et forteresses, qui furent incorporés au nouveau royaume des Pays-Bas. S'en suit une ère de prospérité due à ses nombreuses richesses et à l'industrialisation.
Sous le Premier Empire, la Flandre cessa d'être le théâtre de la guerre. Elle avait accueilli avec peu d'empressement les idées révolutionnaires, sans toutefois y opposer une réelle résistance. Mais elle avait fourni d'excellents soldats et continua d'en donner aux armées de Napoléon. En 1814, ses villes furent assiégées et, après les Cent Jours, la région subit l'occupation et perdit quelques districts et forteresses, qui furent incorporés au nouveau royaume des Pays-Bas. S'en suit une ère de prospérité due à ses nombreuses richesses et à l'industrialisation.
Contexte politique et institutionnel
La mise en place du Consulat puis du Premier Empire entraîne l’imposition d’un modèle administratif centralisé. Les départements picards sont désormais dirigés par des préfets chargés d’appliquer les consignes parisiennes, de superviser les levées militaires et d’organiser la collecte fiscale. Le Code civil, l’état civil modernisé et la réforme judiciaire introduisent des cadres juridiques et documentaires qui durent tout au long du XIXe siècle. Le cadastre napoléonien rationalise la propriété foncière, facilitant la lecture postérieure des transferts de terres et des ventes issues de la Révolution.
Mobilisation militaire et impact démographique
Les conscriptions massives privent les campagnes d’une part importante de leur population jeune. Les registres municipaux et les correspondances montrent des départs réguliers vers les différents théâtres d’opération en Espagne, Allemagne, Italie, Russie, suivis de retours parfois dramatiques. La mortalité de guerre et la dispersion des classes d’âge ont des répercussions visibles sur la production agricole, les mariages et la composition des foyers. Les villages conservent souvent des listes de « disparus » et des plaques rappelant les familles affectées.
Présence et mouvements des troupes sur le territoire
La Picardie sert de couloir logistique entre Paris, la frontière nord et les côtes de la Manche. Cantonnements, convoiements et bivouacs sont fréquents : places fortes et villes de garnison (Amiens, Beauvais, Compiègne, Saint Quentin) accueillent des unités en transit. Pendant les campagnes d’Italie et d’Allemagne, la région voit également passer des convois de blessés et de prisonniers, ainsi que des réserves de fourrage et de munitions. Lors de la campagne de 1814 et de l’avancée alliée en France, la Picardie subit des passages d’armées, des réquisitions et des dégâts matériels ponctuels.
 Économie locale et contraintes du blocus
Économie locale et contraintes du blocus
Le blocus continental et la guerre perturbent les circuits commerciaux traditionnels. Les négociants picards, dont beaucoup dépendaient des exportations ou du transit maritime, subissent pénuries et hausse des prix. Les réquisitions de grains et de chevaux par l’administration impériale pèsent sur les exploitations agricoles. En revanche, certaines administrations locales et entrepreneurs tirent parti des marchés militaires (fournitures, transports), créant des tensions internes entre profiteurs et populations éprouvées.
Réformes, infrastructures et héritage matériel
Napoléon modernise les voies de communication utiles à la manœuvre des troupes et au ravitaillement. Ponts, chaussées et certaines routes stratégiques sont entretenus ou repris selon un cahier des charges centralisé. Le cadastre et l’état civil laissent des archives précises exploitées aujourd’hui par les historiens et les généalogistes. L’urbanisme municipal et l’organisation des services publics se structurent ; les bâtiments préfectoriaux, prisons et casernes construits ou réaménagés à l’époque sont souvent encore identifiables dans les centres villes.
Figures locales et mémoire sociale
Les préfets, maires, officiers de gendarmerie et notaires locaux incarnent l’application des politiques impériales au quotidien. Les lettres de conscrits, les registres des sociétés locales et les journaux de paroisse conservent une mémoire vive des épreuves. Après 1815, la mémoire napoléonienne en Picardie se lit dans les débats publics, les monuments commémoratifs et les collections municipales qui rassemblent uniformes, médailles et correspondances.
XXe siècle et conflits mondiaux
 Première Guerre mondiale en Picardie
Première Guerre mondiale en Picardie
La Première Guerre mondiale marqua tragiquement la région. La bataille de la Somme, en 1916, fut l’une des plus dévastatrices de l’histoire moderne. Bombardements, tranchées et mémoriaux témoignent aujourd’hui encore de cette page douloureuse. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Picardie subit de nouveau les ravages des affrontements et de l’occupation.
La Picardie devient l’un des principaux théâtres de la Première Guerre mondiale : tranchées, batailles de la Somme et destructions massives façonnent une mémoire collective profonde. Les paysages, villages et cimetières de guerre portent la marque de ces événements, devenus des lieux de commémoration internationaux. La Picardie est l’un des territoires français les plus marqués par la Première Guerre mondiale : invasion, front stabilisé sur plusieurs années, batailles d’une ampleur inédite et traces mémorielles omniprésentes dans le paysage.
Campagnes et événements majeurs à retenir
- Mobilisation et avancée allemande d’août septembre 1914 : occupation temporaire d’Amiens et poussée jusqu’à Senlis avant la stabilisation du front après la Marne.
- Bataille de la Somme (juillet–novembre 1916) : offensive alliée majeure en Picardie qui cause des pertes très lourdes et transforme profondément le paysage du département.
- Ligne de front et guerre de tranchées (1914–1918) : secteurs continus de front sur l’Aisne, la Somme et l’Oise, alternance d’offensives et de périodes de moindre activité jusqu’à l’offensive finale de 1918.
Incursions, occupation et retrait allemands, puis reprises de territoires entre 1917 et 1918 selon les fluctuations des campagnes militaires. Les sources contemporaines et synthèses régionales insistent sur la centralité du front picard dans la chronologie du conflit et sur la violence des combats qui s’y sont déroulés.
Vie du front, innovations et horreurs techniques
Guerre de position et quotidien des poilus : tranchées, boyaux, postes d’écoute, ravitaillement par voie ferrée et routes de desserte. Les conditions sanitaires, la boue et l’artillerie d’une intensité nouvelle façonnent l’expérience combattante.
Innovations militaires perceptibles en région : usage massif de l’artillerie lourde, mines et contre mines, essais limités d’aviation et développement des techniques de soins et d’évacuation des blessés. Ces transformations expliquent la nature prolongée et destructrice des opérations en Picardie.
Expérience civile et occupation
Zones occupées et conséquences : une partie importante de l’Aisne, de la Somme et de l’Oise subit occupation allemande avec isolement des populations, difficultés de correspondance et germanisation partielle de certaines administrations locales durant les périodes d’occupation.
Déplacements de populations, réquisitions, restrictions alimentaires et pertes matérielles massives modifient durablement la démographie et l’économie locale; fouilles et patrimoines montrent caches monétaires, destructions d’églises et réemplois de matériaux de guerre dans les reconstructions d’après guerre.
 Chronologie
Chronologie
- Septembre-octobre 1914 : les troupes allemandes envahissent la Picardie ; elles occupent le Chemin des Dames.
- 1er juillet 1916 : lancement de la terrible bataille de la Somme qui durera plusieurs mois et fera au total près de 1,2 million de victimes, tués ou blessés.
- 16 avril 1917 : le général Nivelle lance l’offensive sur le Chemin des Dames qui se solde par un terrible échec. Les mutineries vont ensuite se multiplier dans le camp français.
- 1918 : en mars, à Doullens, Foch et les dirigeants des Alliés s’accordent sur un commandement unique ; l’armée australienne arrête les Allemands à Villers-Bretonneux le 27 avril ; le 11 novembre, signature de l’armistice dans un wagon en forêt de Compiègne.
Mémoire, musées et sites incontournables à visiter
- Champ de bataille et mémoriaux de la Somme (Thiepval et nombreux cimetières du Commonwealth) pour comprendre l’échelle des pertes et la topographie du combat.
- Historial de la Grande Guerre à Péronne : musée de référence sur la Somme et la guerre de 1914–1918, collections et parcours pédagogique pour visiteurs et chercheurs.
- Musées et parcours de mémoire locaux (Amiens, Albert, Péronne) et sites d’interprétation (tranchées reconstituées, observatoires) qui restituent vies militaires et civiles pendant la guerre.
Itinéraire suggéré (1–2 jours) :
Amiens (mémoires urbaines et archives) → Albert/Thiepval (musées et mémoriaux de la Somme) → Péronne (Historial) avec haltes sur cimetières et sections de ligne de front conservées.
Seconde Guerre mondiale en Picardie
La Picardie fut un des territoires français les plus exposés lors de la Seconde Guerre mondiale : invasion et débâcle de 1940, longue occupation allemande, développement d’un réseau résistant actif, déportations et réquisitions, puis libération en 1944 accompagnée de combats, de destructions et d’une reconstruction lourde après guerre.
1940 : invasion, débâcle et occupation initiale
En mai juin 1940 la percée allemande à l’ouest des Ardennes contourne la ligne défensive française et conduit rapidement au repli des armées alliées ; des axes routiers picards sont utilisés par les colonnes allemandes pour avancer vers le nord et Paris. Villes et territoires subissent évacuations massives de civils, bombardements tactiques et occupation militaire. Certaines localités connaissent pillages, réquisitions et installation de garnisons.
Après l’armistice de juin 1940 la Picardie se trouve entièrement en zone occupée ; l’administration allemande organise le contrôle des transports, des industries et des sites logistiques.
 Vie sous l’occupation : répression, économie et société
Vie sous l’occupation : répression, économie et société
Réquisitions et contraintes économiques : produits agricoles, chevaux, ateliers et voies ferrées sont réquisitionnés pour l’effort de guerre allemand ; le ravitaillement civil se dégrade, rationnements et pénuries s’installent.
Collaboration et administration : notables locaux, préfets et mairies doivent composer avec l’autorité d’occupation, ce qui entraîne parfois des compromis, parfois des résistances administratives.
Répression politique et policière : arrestations, interrogatoires et surveillance des opposants ; opérations de police conduites par la Gestapo et les services allemands, appuyées par des services de renseignement locaux.
La persécution et la déportation : Juifs, résistants et otages civils ; arrestations suivies de transferts vers centres de transit (notamment camps ou lieux de rassemblement) puis déportation vers Auschwitz et autres camps nazis. Camps et lieux de détention en Picardie : Compiègne (camp de Royallieu) fut un lieu d’internement et de transit notable utilisé par l’occupant pour regrouper des internés et déportés avant leur transfert vers l’Est; archives et mémoriaux documentent ces itinéraires tragiques.
Résistance, actions et répression
La Résistance picarde a combiné activités clandestines locales et actions coordonnées avec les réseaux nationaux, mêlant renseignement, sabotage, aide aux évadés, propagande, actions armées et soutien logistique aux Alliés. Actions de groupes FTP et FFI, hébergements d’agents de liaison, filières d’évasion, et participation de la population (logistique, caches, renseignement).
Renseignement et transmission d’informations : Collecte d’informations sur les mouvements ennemis, signalement des convois et des dépôts, observation des installations militaires et transmission des renseignements aux services alliés ou aux réseaux par des agents de liaison. Ces activités s’appuyaient sur des réseaux de passeurs et de correspondants locaux qui relayaient vers Paris ou vers les émetteurs clandestins.
Multiplication des réseaux : organisations gaullistes (Combattants de la France libre, réseaux de la France libre), communistes (FTP), groupes régionaux d’information et d’action, et maquis s’organisent pour sabotage ferroviaire, renseignement, aide aux évadés et actions armées.
Sabotage des infrastructures et logistique ennemie : attaques sur lignes de chemin de fer, postes de télécommunication, dépôts de munitions et camions pour perturber l’acheminement des troupes et du matériel vers le front de l’Est et la Manche. Attaques ciblées sur voies ferrées, lignes téléphoniques, ponts, dépôts de munitions et véhicules pour retarder les mouvements allemands et fragiliser la logistique ennemie. Le sabotage visait à maximiser l’effet sur le ravitaillement sans nécessairement engager des combats frontaux coûteux pour des petits groupes locaux.
Actions armées, embuscades et guérilla locale : Réalisation d’embuscades ponctuelles contre patrouilles, sabotage armé de véhicules et prise d’objectifs tactiques lors des vagues de libération ou pour protéger opérations de sabotage. Ces actions étaient généralement conduites par les FFI et les FTP en coordination avec les réseaux locaux et souvent synchronisées avec les débarquements alliés ou les offensives extérieures.
Aide aux évadés, réfractaires et pilotes alliés : Organisation de filières d’exfiltration et d’hébergement pour réfractaires au STO, militaires évadés et aviateurs abattus; constitution de caches, faux papiers et itinéraires sûrs vers la zone libre ou vers des points d’embarquement. Ces filières mobilisaient civils, agriculteurs et familles d’accueil pour garantir discrétion et sécurité.
Grèves, désobéissance civile et pressions économiques : Appels à la grève, refus de livrer denrées aux autorités d’occupation, ralentissements de la production et sabotages industriels discrets afin d’affaiblir l’effort de guerre allemand et de créer des tensions entre administrations locales et autorités d’occupation.
Presse clandestine, information et contre propagande : Diffusion de tracts, journaux clandestins et bulletins d’information locaux pour maintenir le moral, comprendre les consignes de sabotage et contrer la propagande allemande et de Vichy. La presse clandestine servait aussi d’outil d’organisation en appelant à la grève, à la désobéissance ou à des mouvements spécifiques.
Financement, collecte de matériel et approvisionnements : Levées clandestines de fonds, réquisitions ciblées et récupération de ressources pour armer et équiper les groupes résistants ; appui des populations locales et des sympathisants pour fournir nourriture, hébergement et pièces détachées nécessaires aux sabotage et à la survie des cellules.
Répression violente : arrestations massives, tortures, exécutions sommaires et déportations vers camps de concentration ou de travail; certains quartiers d’Amiens, Compiègne et autres villes conservent la mémoire d’exécutions et de rafles.
Contre stratégies face à la répression : Dispersion des cellules, rotation des postes de liaison, utilisation de codes et de procédures d’urgence pour limiter l’impact des arrestations et des infiltrations; recours à la clandestinité la plus stricte dans les zones à forte surveillance ou après rafles majeures.
Figures emblématiques de la Résistance en Picardie
Rôle des femmes et des civils : Participation active des femmes comme agentes de liaison, hébergeuses, rédactrices de presse clandestine et auxiliaires logistiques; implication civile large dans l’accueil des réseaux et la protection des caches, renforçant la résilience des dispositifs résistants en Picardie.
Leaders et acteurs locaux identifiés dans la mémoire régionale
- René Lamps : résistant originaire de la Somme, actif dans les réseaux locaux et évoqué dans les témoignages audiovisuels consacrés à la Résistance picarde.
- Julia (ou Julienne) Lamps : militante et agente de liaison dans la Somme, citée dans des reportages et témoignages sur les FTP et les actions de sabotage en Picardie.
- Le groupe dit « Michel » : cellule locale documentée pour son action et sa répression par les autorités d’occupation. L’exécution collective du groupe reste un épisode marquant des poursuites et des représailles en Picardie.
- Colonel Pierre Vaujois : responsable militaire local évoqué dans les témoignages oraux sur l’organisation des éléments de la Résistance et la libération régionale.
- Pierre Guillot : membre d’un réseau local cité dans archives orales et dossiers de témoignage sur les sabotages et la coordination avec les unités alliées.
- Charles Sellier : résistant dont l’activité figure dans des reportages et inventaires de la Somme pour les opérations de terrain.
- Jacques Lerouge : chef de maquis (ex. maquis de Gamaches) connu pour actions de guérilla et hébergement d’évadés.
- Lucien Boubert : militant local actif dans des filières d’évasion et l’accueil d’aviateurs alliés ; souvent cité avec Renée Boubert.
- Renée Boubert : agente de liaison et hébergeuse, impliquée dans des réseaux d’aide aux réfractaires et aux évadés.
- Pierre Dassonville : militant et acteur de la mémoire locale, fréquemment cité dans travaux et débats publics sur la Résistance dans la Somme.
Bombardements, front logistique et offensives de 1944
- Cibles alliées : nœuds ferroviaires, ponts et centres industriels picards sont régulièrement bombardés par les forces alliées pour affaiblir la logistique allemande; ces raids causent des pertes et des destructions civiles importantes.
- Libération 1944 : après le débarquement en Normandie, la progression alliée vers le nord est atteint la Picardie durant l’été et l’automne 1944; villes comme Amiens sont libérées fin août début septembre 1944 au prix d’affrontements localisés, opérations de chasse aux garnisons ennemies et poursuite des colonnes allemandes en retraite.
- Combats de retraite et dégâts : passages de combats retardateurs, sabotage des infrastructures par les Allemands (retrait stratégique), incendies et destructions d’ouvrages d’art.
Chronologie
- Mai 1940 : Amiens est bombardée, plus de la moitié des maisons sont détruites, la cathédrale en réchappe miraculeusement.
- 1940 : l'armistice entre la France et l'Allemagne est signé à Rethondes dans le fameux wagon, Hitler voulant laver l'affront de 1918.
- 1941 : ouverture du camp de Royallieu, près de Compiègne.
- Mai 1944 : bombardements intensifs sur Amiens.
Mémoire, patrimoine et lieux de visite
- Camp de Royallieu (Compiègne) : musée-mémorial et lieu d’histoire consacré à l’internement et à la déportation.
- Musées et centres de mémoire : musées municipaux et départementaux d’Amiens, Saint Quentin, Péronne et autres abritent collections, expositions et parcours sur l’occupation, la Résistance et la libération.
- Stèles et cimetières : monuments aux morts, plaques commémoratives et cimetières militaires rendent compte des victimes civiles et militaires; cimetières alliés et ossuaires témoignent aussi de l’envergure des pertes.
Itinéraire thématique Seconde Guerre mondiale en Picardie - 1 à 3 jours
Parcours pour lire l’occupation, la Résistance, la déportation et la libération en Picardie à travers musées, lieux de mémoire et sites d’interprétation.
- Jour 1 : Amiens et Compiègne : Administration, internement et résistance
Matin Amiens : visite du musée municipal et du centre ville pour repérer les traces des occupations, les plaques commémoratives et les itinéraires urbains de la Résistance. Consulter les documents et expositions temporaires en ville.
Après midi Compiègne : Camp de Royallieu (mémorial et musée site consacré à l’internement et à la déportation) pour comprendre la politique d’arrestation, les parcours de déportation et les archives du lieu.
Soir — temps d’écriture ou synthèse pour intégrer témoignages et citations issus des panneaux d’interprétation et des collections.
- Jour 2 La Somme : bombardements, logistique et réseaux de résistance
Matin Albert et Thiepval : mémoriaux et cimetières alliés pour appréhender l’impact des bombardements et la topographie des destructions; lectures des noms et des inscriptions funéraires.
Midi halte dans une petite commune pour repérer panneaux locaux sur les bombardements stratégiques et les raids aériens.
Après midi Historial de Péronne : musée majeur sur la Grande Guerre et les enjeux mémoriels de la Somme qui complète la lecture des conflits à l’échelle régionale et des logiques de bombardements et d’occupation.
Fin de journée visite de villages reconstruits et observation des scarifications urbaines dues aux raids et aux combats.
- Jour 3 : Itinéraire du souvenir, sites de combat et coulisses de la logistique
Matin Circuit du Souvenir (parcours recommandé dans la Somme) : suivre une portion du circuit pour relier plusieurs sites de mémoire, musées et vestiges de champs de bataille et lire la guerre dans le paysage.
Midi pique nique près d’un site mémoriel ou repas dans une auberge commémorative.
Après midi reconstitutions de tranchées, observatoires et visites guidées sur un secteur conservé; consultation des panneaux d’interprétation pour les aspects techniques (rail, ravitaillement, bombardement).
Fin de journée — arrêt dans un cimetière allié pour écouter les guidages audio et terminer l’itinéraire en concluant sur la mémoire internationale du conflit.
Musées et sites recommandés
- Camp de Royallieu, Compiègne — musée mémorial dédié à l’internement et à la déportation; dossier documentaire et parcours d’interprétation.
- Historial de Péronne — musée référence sur la Somme et la Grande Guerre, utile pour replacer bombardements et occupation dans un contexte régional.
- Circuit du Souvenir de la Somme — itinéraire balisé reliant mémoriaux, cimetières et sites de bataille; utiliser ce circuit pour structurer la journée et visiter des sites clés.
Horaires, réservations et conseils pratiques
- Prévoir 1 journée par grand pôle mémoriel (Compiègne, Péronne, secteur du Circuit du Souvenir) pour profiter des expositions et des promenades guidées.
- Vérifier les jours d’ouverture et réserver les visites guidées ou créneaux pour musées et parcours commentés via offices de tourisme locaux.
- Prendre des chaussures de marche, eau, protection contre la pluie, et une carte papier ou un GPS ; certaines sections du Circuit du Souvenir nécessitent des déplacements en voiture entre points d’intérêt. Sources: Somme tourisme.
Une identité culturelle forte et un patrimoine valorisé
Aujourd’hui, la Picardie se présente comme un territoire souhaitant concilier mémoire, développement durable et attractivité touristique. Au XXe siècle la Picardie acquiert une forme administrative moderne, puis connaît une nouvelle étape en 2016 avec la fusion dans une région plus vaste. Ces recompositions posent des enjeux d’identité, de gouvernance et de valorisation économique. La Picardie se lit à travers ses monuments gothiques, ses traces de conflits mondiaux, ses villages et ses savoir-faire ruraux.
La langue picarde et ses variantes, les traditions rurales, les fêtes locales et la gastronomie (produits du terroir, marchés) constituent le socle d’une identité régionale vivante. Le patrimoine bâti — fermes, halles, boves, beffrois et cathédrales — et les paysages (plaines, marais, littoral) contribuent à une image reconnue et valorisée par le tourisme culturel et la protection patrimoniale.
Pour qui veut explorer la région : privilégier une combinaison de visites de cathédrales, de musées de mémoire, de circuits paysagers le long de la Somme et de découvertes gourmandes permet de saisir la diversité et la profondeur de son histoire. Suggestions de visites rapides : cathédrale d’Amiens, basilique de Saint-Quentin, nécropoles et musées de la Grande Guerre, villages du Ponthieu et sentiers de la baie de Somme.
Nos coups de coeur dans la Picardie
Hébergement :
Restauration :
Les dernières news touristiques
N'oubliez pas !
Les lieux les plus enchanteurs sont souvent les plus vulnérables. L'affluence du tourisme pouvant fragiliser encore plus les lieux, veillez à en prendre soin et à ne laisser aucune trace de votre passage. Par respect pour les habitants et l'environnement, merci de respecter le droit de propriété et à la vie privée, respecter les panneaux signalétiques et consignes.
- Veillez à toujours respecter les biens et les personnes lors de votre passage et de ne pas pénétrer sur les terrains privés.
- Observez le code de la route en tous lieux et en toutes circonstances, et soyez courtois avec les autres usagers que vous pourrez croiser sur votre chemin.
- Camping et Feux interdits (pas de barbecue) - La nature est fragile et des chutes de pierres sont parfois fréquentes.
- Veuillez ramasser vos déchets avant de partir. Plus que les sacs plastiques ou les pailles, ce sont les mégots de cigarettes qui pollueraient le plus les océans. les filtres à cigarettes se dégradent très lentement. Deux ans en moyenne. L'un des "petits gestes élémentaires" à accomplir : ne plus jeter ses mégots par terre. Pensez boite à mégots.
Soyez vigilants et attentifs à tous ces petits gestes pour que nos petits et grands paradis le reste encore de nombreuses années et que les personnes qui passeront derrière nous en profitent tout autant.
Préparez vos vacances dans la Picardie avec nos partenaires
Trouver un séjour dans la Picardie avec nos partenaires
Picardie tourisme Picardie histoire
Ajouter un commentaire

